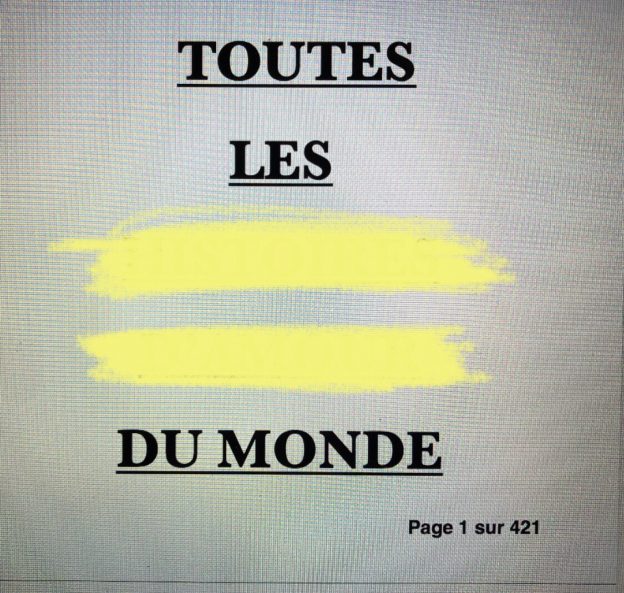(Photo : R. Magritte)
Témoignage recueilli et écrit par la romancière et sage-femme (et amie) Agnès Ledig.
Alors voilà, c’est l’histoire d’une femme…
Je ne la connais pas encore. Je la vois en urgence, parce qu’elle appelle au secours, parce qu’elle ne dort plus, qu’elle est sur le point de vaciller. Je n’ai qu’un pauvre petit créneau de trente minutes pour tout découvrir d’elle, et tenter de lui donner quelques outils avant qu’elle ne reparte vers la nuit suivante. Je ferai ce que je peux…
Elle a accouché il y a quelques jours seulement. Premier bébé.
Enfin…
Pas tout à fait.
Elle a accouché il y a quelques jours seulement et elle n’en dort plus.
Elle pense trop.
À l’autre.
Elle a attendu d’avoir vingt-huit ans pour envisager un enfant, avec un conjoint attentionné et une situation de vie rassurante et propice à l’agrandissement familial.
Oui, mais.
Il y a eu cette autre grossesse inopinée, il y a quelques années, dans un autre contexte, avec un autre géniteur, et une situation ni propice ni rassurante. Tellement difficile, même, qu’elle a préféré l’interrompre, et fuir (le géniteur).
Oui, mais.
Ce n’est pas si simple quand on est une femme, quand on porte la vie, quand on doit cesser de le faire, et qu’en plus c’est volontaire. C’est difficile, parce qu’outre le jugement des autres, il y a sa propre culpabilité d’en décider ainsi, sa propre tristesse de laisser partir ce bout de vie qui s’était installé au chaud, et auquel on s’était déjà attaché. Parfois, on s’y attache dès le deuxième trait du test de grossesse, même si l’idée d’être enceinte, à ce moment-là, est une catastrophe en soit.
C’est toute cette culpabilité, toute cette tristesse que Lucille me raconte pendant de longues minutes. Elle s’était déjà attachée à ce bébé, elle lui avait même donné un prénom, mais elle ne pouvait pas le garder, de peur de lui offrir une vie de peines. Elle avait mis des couvercles bien lourds au dessus de tout cela. Un pour la culpabilité, un autre pour la tristesse, un troisième pour que ça tienne, et que rien ne déborde.
Mais une nouvelle grossesse, et tout explose, les deux couvercles et le troisième, et la voilà qui replonge plus fort encore dans la tristesse et la culpabilité. Et pourquoi ce bébé-là a droit à la vie et pas l’autre ? Ses mots sont très forts. Très durs envers elle-même. Les larmes coulent, parce que le nouveau bébé est là, qu’elle l’aime, mais qu’elle n’en dort pas.
Je commence par mettre des mots sur sa peine.
Vous vous sentez coupable n’est-ce pas ?
Oui.
Et vous vous étiez déjà attachée à ce bébé…
Oui, je lui avais même écrit un poème.
Et cette nouvelle grossesse vous rappelle qu’il y a eu la précédente.
Oui. Je me sens très mal depuis que je suis enceinte.
Mettre des mots sur les maux, c’est déjà mettre du baume sur les plaies, parce qu’elle sait que j’ai entendu son chagrin, que je le comprends. C’est comme prendre dans les bras, avec la parole.
Premier pas.
Le deuxième sera de lui donner quelques éléments de ma boîte à outils. Quelques phrases sur des petites cartes, pour l’accompagner.
“Je fais de mon mieux,
Dans le respect de moi-même,
Avec les cartes de l’instant,
Le reste appartient à la vie.”
Nous décortiquons ensemble. Elle a fait de son mieux il y a quelques années. Elle était dans le respect d’elle-même en prenant cette décision, parce que le futur père la frappait, et qu’ajouter un bébé au tableau aurait été de l’huile sur un feu déjà insupportable. Les cartes de l’instant n’étaient pas propices à une poursuite heureuse de cette grossesse.
Le reste appartient à la vie.
Je lui demande si, par hasard, ce bébé qui s’est invité par surprise à ce moment-là ne serait pas venu juste pour lui permettre à elle de partir. Parce que ce sont les faits. Parce que donner un sens aux choses douloureuses permet souvent de les apaiser.
Elle acquiesce. L’envie d’y croire.
Le deuxième outil sera donc un arc-en-ciel d’amour de cœur à cœur, à imaginer dès qu’elle pense à lui tristement, pour mettre un peu de couleur et une jolie émotion sur la mélancolie. Puisqu’elle l’a aimée cette petite entité venue pour ce morceau de temps, infime à l’échelle de l’univers, mais si révélateur pour elle. Je lui propose même de le remercier, ce foetus, pour ce qu’il a fait pour elle, et de lui laisser une place dans le cœur. Puisqu’elle l’a aimé.
Puisqu’elle l’a aimé, mais qu’elle a fait de son mieux avec les cartes de l’instant.
Elle pleure toujours, mais cette fois-ci de soulagement.
Je suppose qu’à son propre jugement s’ajoute depuis des jours, des semaines, des années, celui qu’elle imagine chez les autres. Mais qui serais-je pour oser en faire de même ? Elle est venue parce qu’elle va mal, parce qu’elle cherche de l’aide. On n’assomme pas quelqu’un qui est déjà au sol. Encore moins quand il vous tend la main, confiant, en vous demandant de lui porter secours.
Je lui donne donc la petite carte du non-jugement, puisque la décision lui appartient. À elle et à elle seule de « juger » de ce qui fut bon pour elle il y a quelques années.
Ces femmes qui sont mortes sous les doigts et l’aiguille à tricoter des faiseuses d’anges, elles ont fait de leur mieux avec les cartes de l’instant… et on les jugeait.
Ces femmes qui ont souffert le martyr quand on arrachait de leurs entrailles un possible qui ne pouvait pas y rester et à qui l’ont disait « ça vous passera l’envie de recommencer », elles ont fait de leur mieux, avec les cartes de l’instant… et on les jugeait.
Lucille, il y a quelques années, n’est pas morte, n’a pas souffert le martyr dans son corps, mais elle a trimballé pendant tout ce temps le poids énorme de la culpabilité, qui aurait pu peser sur cette petite fille, née il y a quelques jours.
Mais Lucille sourit en face de moi. Elle a compris, entendu, intégré qu’elle a fait de son mieux, dans le respect d’elle-même. Elle sourit parce qu’elle se sent légère.
Plus besoin de couvercles, ni un, ni deux, ni trois, puisqu’elle y a mis à la place de la bienveillance, de la reconnaissance, et un bel arc-en-ciel d’amour pour ce bébé qui n’a fait que passer…